« L’Autobiographie homosexuelle en question »
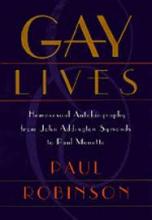
Robinson Paul, Gay Lives. Homosexual Autobiography from John Addington Symonds to Paul Monette, Chicago / Londres, The University of Chicago Press, 1999, 456 p.
Gay Lives. Homosexual Autobiography from John Addington Symonds to Paul Monette est une imposante étude organisée en six parties. Chaque partie est consacrée à deux ou trois autobiographes. La première partie traite de John Addington Symonds et Goldsworthy Lowes Dickinson, la deuxième porte sur Christopher Isherwood et Stephen Spender, la troisième sur J. R. Ackerley et Quentin Crisp, la quatrième – consacrée aux auteurs français – porte sur Gide, Genet, et Green, enfin les deux dernières sont consacrées aux Américains : tout d’abord à deux diaristes – Jeb Alexander et Donald Vining – puis, pour le dernier chapitre qui nous emmène jusqu’aux années 1990, à Andrew Tobias, Martin Duberman, et Paul Monette. Le corpus dont Robinson se dote comprend donc quatorze auteurs, mais quinze ouvrages (treize autobiographies et deux journaux intimes), car Isherwood fournit la matière de deux chapitres : l’un portant sur Lions and Shadows, l’autre sur Christopher and His Kind. Chaque partie est précédée d’une introduction de quelques pages proposant une synthèse des observations à suivre et justifiant le rapprochement des autobiographies mises en regard : ce sont souvent les meilleures pages du livre, puisque ce sont celles qui permettent une réflexion générale sur « l’autobiographie homosexuelle » et dressent les acquis conceptuels tirés de l’observation des œuvres. À ces (trop brèves) introductions près, l’ouvrage se présente comme une suite d’études de cas plutôt que comme un essai sur ce que serait l’autobiographie homosexuelle et ses spécificités, études de cas auxquelles s’ajoutent encore une introduction générale d’une vingtaine de pages – occasion des réflexions les plus intéressantes puisque Robinson y pose les bases définitionnelles pour penser cet objet littéraire méconnu que serait l’autobiographie homosexuelle – et un épilogue d’une quinzaine de pages ouvrant sur la question des autobiographes homosexuels noirs ou issus de la minorité latino-américaine.
Un objet littéraire à définir
Le grand mérite de Robinson est de penser l’autobiographie homosexuelle comme objet littéraire à part entière, comme un sous-genre de l’autobiographie, avec ses topoi, ses attendus, ses variations historiques et – il s’agit de l’un des grands enjeux de l’essai de Robinson – géographiques.
Que serait l’autobiographie homosexuelle – ou autobiographie gaie ? Robinson en propose des traits définitionnels dans l’introduction générale, où il justifie le choix de son corpus. L’intuition essentielle est qu’il ne suffit pas d’être homosexuel et autobiographe pour écrire une autobiographie homosexuelle ; il faut que l’homosexualité soit le sujet central (ou l’un des sujets centraux) de l’écriture autobiographique et non pas un sujet incident : « I use the phrase “gay autobiographer”, sometimes anachronistically, to identify writers who make attraction to their own sex a central theme of their autobiographies », écrit Robinson (p. IX). Un tel critère est parfois sujet à débat : Lions and Shadows, Robinson le souligne, pourrait paraître ne pas y répondre – Robinson justifiera son choix d’inclure la première autobiographie d’Isherwood en la lisant comme une « autobiographie homosexuelle codée » (ibid.), suggérant toujours l’homosexualité pour le lecteur désireux de l’y trouver, mais ne l’explicitant jamais. Ce premier critère définitionnel – l’autobiographie doit avoir pour enjeu central la thématique homosexuelle – mène à l’exclusion, par exemple, de l’autobiographie de Gore Vidal, Palimpsest (1995), dans laquelle l’auteur n’a pas pour souci principal d’écrire « his sexual life or his evolving identity as a gay man » (ibid.), mais bien plutôt d’évoquer ses amitiés et inimitiés politiques et littéraires.
Le second critère de Robinson dans l’élaboration de son corpus porte sur le statut de l’auteur dans le champ littéraire ou intellectuel : Robinson ne considère que les biographies d’artistes ou d’intellectuels (p. X). Cela exclut l’autobiographie d’un agent du FBI homosexuel, d’un sportif récemment sorti du placard, d’un politicien amateur de beaux garçons, ou de soldats gais renvoyés de l’armée américaine. De tels livres concernent moins l’histoire érotique et le questionnement identitaire de leur auteur que la lutte contre les préjugés dans tel ou tel milieu, dit Robinson, ce qui indique que l’autobiographie homosexuelle telle que Robinson la conçoit doit procéder autrement : elle n’est pas étude des préjugés, mais récit de vie centré sur les amours et la constitution de l’identité de l’homme homosexuel. Ce second critère est sans doute malaisé à employer, et le lecteur peut se demander si tous les auteurs retenus par Robinson méritent bien d’être dits des « intellectuels » : Jeb Alexander (au reste, un diariste et non un autobiographe), qui n’a rien publié de son vivant et a occupé des emplois administratifs toute sa vie (« a government clerk in Washington, D.C. », écrit Robinson p. 264) mérite-t-il d’être dit un « intellectuel » ? La légitimité de l’intellectuel est un critère que l’étude confère à ses auteurs par le fait même de les étudier. Reste que le lecteur pourra trouver suspecte la rencontre du spécialiste en assurances Andrew Tobias et du sémillant acteur Quentin Crisp avec Gide ou Genet : cette disparité du corpus laisse présager le principal défaut du livre, à savoir qu’il se présente moins comme une étude littéraire qu’une étude du témoignage.
Après avoir défini ce que serait une « autobiographie homosexuelle », Robinson (p. XIII) dégage trois grandes catégories au travers desquelles il va observer les textes de son corpus : l’identité, la masculinité et la solidarité. Robinson étudie les auteurs de son corpus en s’interrogeant sur la manière dont ils se considèrent eux-mêmes du point de vue de leur identité sexuelle (leur sexualité est-elle pensée comme innée ou acquise, est-elle acceptée ou combattue ?), ce que cela implique dans leur positionnement de genre, et la manière dont ils regardent les autres homosexuels.
La fin de l’introduction (p. XX) soulève la question évidente de la place des autobiographies écrites par des femmes homosexuelles, exclues du corpus : l’étude aurait-elle dû les inclure ? C’était l’ambition initiale de Robinson, dont le corpus féminin était déjà en partie constitué : Violette Leduc (La Bâtarde), Audre Lorde (Zami), Jill Johnston (Mother Bound et Paper Daughter), Margarethe Cammermeyer (Serving in Silence) et Meredith Maran (What It’s Like to Live Now). Robinson appelle de ses vœux une étude sur l’autobiographie lesbienne et des comparaisons avec son pendant masculin, mais il renonce à inclure un corpus mixte : les autobiographies lesbiennes seraient trop différentes de celles de leurs homologues masculins. Que ce soit dans le rapport à la sexualité, dans le récit de la découverte de l’homosexualité ou dans les relations homosociales, l’expérience lesbienne est jugée trop éloignée de l’expérience homosexuelle masculine pour justifier un corpus mixte.
Tendances nationales des autobiographes homosexuels
Le corpus de Robinson obéit à un souci de variété : il s’agit d’obtenir l’empan chronologique et géographique le plus large possible. Les Memoirs de John Addington Symonds ne sont publiés qu’en 1984 mais sont rédigés en 1889-1890, un siècle avant le texte le plus récent du corpus, Becoming a Man, de Paul Monette, publié en 1992.
Robinson voulait un corpus incluant des autobiographes de différents pays, et le livre s’organise en fonction des nationalités, qui structurent les parties de l’ouvrage : après six Anglais, suivis de trois Français, on passe aux cinq auteurs américains. À l’intérieur des sections par pays d’origine de l’auteur, l’ordre est chronologique (Gide puis Genet, puis Green, ce dernier étant né dix avant Genet mais ayant publié le premier volume de son autobiographie – Partir avant le jour – en 1963, soit quatorze ans après Journal du voleur). Robinson trouve étonnement peu d’Allemands – pas assez pour leur consacrer une section, les Allemands sont donc absents de l’étude – et aucune autobiographie homosexuelle américaine ayant été écrite avant les années 1970, ce qui l’amène à infléchir un peu ses critères de sélection pour faire entrer des diaristes dans son corpus américain : Jeb Alexander, dont le journal (Jeb and Dash) couvre les années 1912-1964 et a été publié en 1993, et Donald Vining, dont le journal (A Gay Diary) va de 1933 à 1982 et a été publié entre 1979 et 1993.
Le projet de comparer les autobiographies homosexuelles en fonction de critères nationaux est sans doute séduisant. La caractéristique principale de l’autobiographie homosexuelle anglaise, selon Robinson, semble être à trouver dans l’érotisation des rapports de classe : Spender explique que la différence de classe sociale entre lui et son amant – Jimmy – confère à l’être aimé un caractère de mystère qui supplée la différence sexuelle que l’on trouve dans le couple hétérosexuel. Robinson (p. 81-82) reprend l’idée et la généralise en en faisant une tendance constante des autobiographes anglais, révélatrice de l’état de leur société fortement hiérarchisée. La classe participe à l’impression d’« otherness » (le terme apparaît, par exemple, p. 12, à propos de Symonds amoureux du fils d’un tailleur), l’impression de ce qui est autre, vaguement mystérieux, et, partant, elle participe à la fascination amoureuse.
Les Français connaissent également une « quête de l’altérité » (« quest for otherness », p. 18), qui ne passe pas tant par le critère de la classe sociale que par la recherche d’une sorte d’exotisme que Gide trouve dans la compagnie des garçons d’Afrique du Nord, Genet en Espagne ou en Europe de l’Est, et Green dans le sud des États-Unis. À vrai dire, la différence avec les Anglais n’est pas toujours très marquée : Symonds part satisfaire ses amours en Suisse et à Venise, Isherwood et Spender vont à Berlin, et la différence du colon au colonisé chez Gide a quelque chose à voir avec la différence de classe puisqu’elle inclut un rapport social de dominant à dominé. Outre la fascination pour la différence ethnique ou nationale, les autobiographes français (p. 173) se distinguent par leur esprit philosophique, leur goût de l’abstraction, leur ambition conceptuelle. Ainsi Gide inscrit-il sa sexualité dans un dualisme entre corps et esprit, tel que l’homosexualité renverrait au corps, et l’amour en serait banni (ce qui mériterait quelques nuances : la relation de Gide avec Lionel exclut la sexualité, mais inclut l’amour). Genet fait de sa sexualité un choix éthique. Green confronte sa sexualité au catholicisme et la pense comme le terrain où s’affrontent Dieu et Satan. Une autre spécificité française (p. 175) serait à trouver dans une certaine liberté de ton quant à l’homosexualité : il n’y aurait pas chez les Français la gêne des Anglais concernant la sexualité entre hommes. Cela ne signifie pas nécessairement l’absence de toute honte, mais les Français seraient moins tentés de dissimuler leurs penchants : Green craint les feux de l’enfer, non la condamnation sociale. Cette relative liberté de parole n’est pas étrangère au fait que Gide publie Si le grain ne meurt bien avant que les autobiographes anglais ou américains ne le suivent dans la voie de l’autobiographie homosexuelle. Gide publie vingt-cinq ans avant Spender, et il est pourtant beaucoup plus enclin que lui à montrer la sexualité pour ce qu’elle est.
Le fameux « placard » théorisé par Eve Kosofsky Sedgwick serait « deeply muted, in fact virtually nonexistent, among the French » (ibid.). L’affirmation mériterait sans doute d’être nuancée, on voit Green dissimuler ceux de ses dessins qui pourraient révéler ses penchants, et tenter en vain d’avouer son amour à Marc, et chez lui le secret est un thème fondamental tant dans l’autobiographie que dans les romans (on pense au Angus de Chaque homme dans sa nuit, au Praileau de Moïra, accablés par leur besoin d’aveu), reste que l’autobiographie homosexuelle française ne s’organiserait pas autour de l’épreuve de la révélation, qui est en revanche l’élément structurant de l’autobiographie homosexuelle américaine.
Les Américains viennent à l’autobiographie homosexuelle bien tard : Robinson n’en a pas trouvé avant les années 1970 (raison pour laquelle il inclut des diaristes, couvrant la période antérieure aux années 1950). Les autobiographies homosexuelles américaines ont pris la forme de « coming-out narratives », racontant comment l’auteur est sorti du placard. C’est la version homosexuelle du récit de transformation de soi, dit Robinson, qui va de saint Augustin à Malcolm X : « the transformation of the old man into the new » (p. 261).
L’expérience singulière et l’expérience partagée : points communs et différences des autobiographies homosexuelles
Si Robinson a pu dégager des tendances nationales, il dit n’avoir pas trouvé une histoire commune à l’ensemble de ces autobiographies, un schéma récurrent (« no such story has emerged, or, if one exists, I have failed to detect it », p. XII). Pour Robinson, c’est la grande variété des expériences qui ressort : l’ouvrage devient une leçon de relativisme appliquée à l’expérience de vie homosexuelle. S’il n’y a pas une histoire commune, l’ensemble des autobiographies a des aspects voulus d’histoire de l’homosexualité, nous montrant une évolution entre les plus anciens autobiographes et les plus récents, qui va d’une plus grande difficulté à s’accepter vers une libération progressive des mœurs et un certain épanouissement sexuel, avec de surprenants achoppements dans la marche vers une sexualité exempte de toute marque de repentance – Green écrit son autobiographie une quarantaine d’années après Gide, mais paraît beaucoup plus coupable, de même que Vining semble accepter ses plaisirs homosexuels, alors que Duberman, né treize ans plus tard, va de psychanalyste en psychanalyste, cherchant à se « guérir ».
Outre l’apport historique, qu’en est-il de l’apport littéraire ? Mis à part quelques brèves remarques sur le genre autobiographique à la fin de l’introduction (p. XXI-XXII), Robinson paraît accorder peu d’importance aux questions génériques, qui devraient pourtant être centrales dans un tel travail. Ajoutons que ces quelques remarques sont étonnamment simplistes : Robinson identifie deux camps, celui de Georges Gusdorf (dont Robinson mentionne l’article « Conditions and limits of Autobiography », dans Autobiography. Essays therotical and Critical, dir. James Olney, Princeton, Princeton University Press, 1980, p. 28-48), qui affirme qu’il n’y pas de différence catégorielle entre roman et autobiographie – ils présenteraient tous deux des événements choisis par l’auteur en faisant appel à l’imagination de ce dernier – et celui de Philippe Lejeune qui oppose autobiographie et fiction. Robinson dit se positionner dans le camp de Lejeune, mais cette bipartition est très artificielle et mène à l’oubli des problématiques proprement génériques posées par l’autobiographie, problématiques qui ne sont pas aussi réductrices que de se demander si l’autobiographie est ou n’est pas une pure fiction mais qui peuvent, par exemple, nous amener à nous interroger sur les stratégies textuelles mises en place afin que le livre ne soit pas lu de la même manière qu’une fiction. Cette absence de réelle confrontation aux travaux portant sur l’autobiographie est d’autant plus regrettable que Lejeune est l’auteur d’un article bien connu consacré à l’autobiographie homosexuelle au XIXe siècle (« Autobiographie et homosexualité en France au XIXe siècle », Romantisme, no 56, 1987, p. 79-94) qui aurait pu permettre des rapprochements fructueux avec les autobiographies les plus anciennes du corpus de Robinson. Le travail de Lejeune, dans cet article, consiste moins à identifier des traits communs qu’à proposer une enquête bibliographique visant à mettre au jour les écrits autobiographiques d’homosexuels publiés au XIXe siècle en France, enquête dont il juge lui-même le résultat bien mince : huit textes autobiographiques, brefs, qui ne répondent pas toujours parfaitement aux critères d’identification du genre autobiographique tels que Lejeune les a lui-même posés, puisque ce sont des récits partiels qui n’englobent pas toute la vie. Ce sont en fait des témoignages d’homosexuels que l’on trouve retranscrits dans des ouvrages médicaux et judiciaires : il aurait été intéressant de confronter une parole homosexuelle prise en charge par un discours médical – qui l’ampute, la commente, et qui lui donne sa raison d’être puisque l’homosexuel qui témoigne est susceptible de se penser lui-même comme comptable de la médecine – à une parole homosexuelle plus intime telle que celle de l’autobiographie de Symonds, rédigée dans la même période que les textes relevés par Lejeune, mais relevant de conditions d’énonciation tout à fait différentes.
Robinson ne le cache pas : son souci n’est pas celui de l’analyse littéraire (« I have tried to keep formal issues in mind. But they have not been my main concern. This is a historian’s book, not a literary critic’s », ibid.), et c’est fort dommage puisque l’ouvrage part de l’intuition – ô combien séduisante – de l’existence d’un sous-genre de l’autobiographie. C’est donc bien une problématique générique qui donne au livre son point de départ : ce dernier n’est toutefois pas une étude de ce que serait l’autobiographie homosexuelle en général mais une étude de l’expérience de vie homosexuelle et de ses métamorphoses en fonction du lieu et de l’époque. En cela, un tel ouvrage déçoit : l’introduction s’ouvre sur l’identification d’une catégorie littéraire et se clôt sur le rejet d’une approche proprement littéraire. Cela ne signifie pas que l’ouvrage de Robinson ne mérite pas toute notre attention du point de vue de l’étude de l’autobiographie et des écrits de soi : de ce point de vue, l’ouvrage de Robinson vaut moins par l’étude qu’il propose que par les voies de réflexion qu’il ouvre. Reste qu’il a le mérite de les ouvrir.
On notera – autre déception pour le littéraire – la faible importance accordée aux relations intertextuelles : Robinson congédie l’intertextualité dès l’introduction (p. XXIII) : « Gay autobiographers write as if they never read the autobiographies of their sexual forebears ». L’autobiographie serait « self-authorizing », elle se passerait de l’appel à la tradition, de la caution des grands modèles ou de la confrontation avec les prédécesseurs : si l’on raconte sa propre vie, il est inutile de regarder les œuvres des autres qui, en termes d’autobiographie, ne concernent que la vie des autres. Pourtant, Beauvoir et Sartre, croyons-nous, n’oublient pas Gide lorsqu’ils écrivent leur autobiographie, et les Jeunes années de Green paraissent avoir de nombreux points communs avec Si le grain ne meurt ; certaines scènes semblent même émigrer d’un livre à l’autre : la mère de Green qui, saisissant un couteau à pain, menace « I’ll cut it off » lorsque le très jeune Julien, sous des couvertures que pour son malheur on a relevées, se caresse sans y penser, rappelle fort le docteur Brouardel menaçant l’enfant Gide de l’amputer de ses pudenda s’il persiste à les manipuler. Robinson note la ressemblance entre les épisodes (p. 237) et reconnaît une certaine « anxiety of influence » (p. 235) de Green à l’égard de Gide – tous deux sont issus de milieux bourgeois, sont d’une religiosité indécrassable, opposent volontiers la chair et l’esprit, se connaissent personnellement et, Gide est mentionné dans l’autobiographie de Green. Voilà qui devrait modérer les affirmations de Robinson à propos de l’absence d’intertextualité : écrire sous influence – ou dans la crainte de l’influence –, c’est, nous semble-t-il, une forme de la relation intertextuelle1. Le problème est que Robinson (là encore) se montre très simplificateur lorsqu’il s’agit des concepts littéraires, avec lesquels il n’est manifestement pas aussi à l’aise qu’il peut l’être avec la méthode historique ou les observations sociologiques : le voici réduisant l’intertextualité à la mention explicite, dans une autobiographie, de l’autobiographie d’un autre, comme c’est le cas chez Isherwood qui confronte directement ses souvenirs à ceux de Spender. Conception bien réductrice de l’intertextualité, qui conduit Robinson à accorder trop peu d’attention à la reprise ou au contournement des modèles autobiographiques antérieurs : si le geste n’est pas explicite, celui-ci n’existe pas.
Une telle difficulté à penser le rapport entre les œuvres n’empêche pas une réflexion transversale, mais qui aurait mérité d’être poussée plus avant, afin de dégager de véritables enjeux littéraires (mais on a bien compris que ce n’était pas là l’ambition de Robinson). Un exemple de ces réflexions transversales peut être à trouver dans la question du lecteur envisagé par l’autobiographe : pour qui écrit-on ce qui – en général – ne peut être dit ? L’hétérosexuel à convaincre ou l’homosexuel auquel il s’agit de montrer qu’il n’est pas seul avec ses particularités ? Robinson n’omet pas la question, mais se contente de la soulever au cas par cas à propos de certains auteurs : on apprend (p. 282) qu’Alexander espérait que son journal serait publié, et lu par des gens comme lui, c’est-à-dire par des homosexuels ; Symonds, lui aussi, écrivait pour le lecteur homosexuel. Tobias, en revanche (p. 318), s’adresse aux hétérosexuels, pour désarmer leurs préjugés. Cette question du lecteur envisagé engage l’entreprise autobiographique même en lui conférant, si ce n’est le but qu’elle se donne pour tâche d’atteindre, en tout cas l’un de ses enjeux fondamentaux et l’une des clés de ses spécificités énonciatives. S’agit-il de l’exception qui s’adresse à l’exception ou de l’exception qui s’adresse à la norme ? Cette réflexion pourrait être nourrie par les remarques de Christine Ligier qui pense l’écriture de soi gidienne comme prise « entre le sentiment d’être une exception et la nécessité d’une mission représentative2 », puisque l’ambivalence entre le particularisme de l’expérience minoritaire et l’ambition de s’ériger en porte-parole d’autres homosexuels est sans doute au cœur de nombreuses autobiographies homosexuelles. Sur ce point, la lecture de Robinson pourrait trouver d’utiles compléments dans la bibliographie critique très fournie consacrée à Si le grain ne meurt – on pense par exemple à Cameron D. E. Tolton qui, dans Gide and the Art of Autobiography, revient assez précisément sur les motivations de l’autobiographe, parmi lesquelles s’entrecroisent préoccupations politiques et souci d’autoreprésentation3, ou encore à Lejeune, qui dans ses Exercices d’ambiguïté lit l’autobiographie gidienne dans sa portée argumentative, répondant point par point au discours d’époque sur l’homosexualité4, l’autobiographie, présentée comme une expérience vraie, jouissant pour ce genre, d’une redoutable efficacité argumentative.
L’attention portée par Robinson à la structure de l’autobiographie homosexuelle américaine – qui s’organise autour de la sortie du placard, opposant la période de dissimulation à la libération finale – aurait pu être déplacée du côté des autres autobiographes. Robinson évoque une certaine tradition critique (il ne nomme pas les critiques) qui oppose l’enfance de Gide, réprimée, et la libération sexuelle qui suit (p. 184) – il est vrai que la structure même de Si le grain ne meurt, en deux parties, invite nécessairement à faire cette opposition puisque la deuxième partie paraît tout entière consacrée à l’exploration d’une sexualité que la première partie laissait insatisfaite. Une telle lecture – que Robinson juge prudent de nuancer – aurait pu mener à des comparaisons éclairantes avec Green, chez qui le bonheur paraît cantonné à la période antérieure à la découverte de la sexualité, laquelle amène son lot de souffrance morale. Manière d’ouvrir à la question de la place structurelle de l’aveu homosexuel dans l’autobiographie : Ackerley retarde l’aveu, alors que Journal du voleur s’ouvre sur des fantasmes homo-érotiques.
Parmi les réflexions de Robinson qui intéressent un lecteur soucieux de préciser les contours de cet objet littéraire que serait l’autobiographie homosexuelle, on peut souligner la distinction faite, p. 91, entre l’autobiographie « closeted » et l’autobiographie « out » : l’autobiographie homosexuelle « dans le placard » et celle qui en est sortie. C’est la comparaison entre Lions and Shadows et Christopher and His Kind qui mène Robinson à poser cette différence. L’audace de cette idée tient au fait que l’autobiographie « dans le placard » pourrait facilement être repoussée en dehors de l’autobiographie homosexuelle telle qu’elle a été définie par Robinson, son principal critère étant que l’homosexualité devait être l’enjeu principal – ou l’un des enjeux principaux – du projet autobiographique. Celui-ci entreprend de lire la première autobiographie d’Isherwood comme une autobiographie homosexuelle codée, ce qu’il justifie de manière souvent ingénieuse – remarquant par exemple l’effacement suspect de tout marqueur de genre lorsque le désir se trouve évoqué : ce ne sont pas là les moins bonnes pages de Robinson. L’autobiographie homosexuelle « dans le placard » induit une double-lecture : le lecteur non averti ne perçoit pas les allusions homosexuelles, mais le lecteur homosexuel, lui, a de fortes chances de trouver suspecte la réticence d’Isherwood à initier des relations charnelles avec de jeunes femmes qu’il préfère abandonner à son ami Tim (p. 53), lequel est bien décidé à en tirer profit (« Tim, who really meant business ») alors qu’Isherwood « was just prentending » – « faisait juste semblant ». De même la tristesse inexplicable de l’autobiographe n’est-elle peut-être inexplicable que pour le lecteur hétérosexuel, alors que les « cognoscenti », comme les appelle Robinson, percevront dans l’impression de solitude d’Isherwood « the familiar alienation of a homosexual ghetto » (p. 54).
Du point de vue de la réflexion générique, on notera certains flottements terminologiques qui ne sont peut-être pas d’une grande gravité pour la pertinence du propos, mais peuvent être l’indice du relatif désintérêt de Robinson pour la question du genre littéraire – sans doute faut-il y voir aussi la marque de conflits terminologiques entre la tradition anglo-saxonne et les études françaises portant sur l’autobiographie. Ainsi Robinson parle-t-il tantôt d’« autobiography » – terme employé dans le titre de l’ouvrage – tantôt de « memoir » (au singulier le plus souvent, parfois au pluriel). Ces termes sont employés indifféremment pour renvoyer aux mêmes ouvrages (My Father and Myself, d’Ackerley, est une « gay autobiography » à la p. 115 mais un « memoir » aux p. 118 et 129). Il est vrai que si le Concise Oxford English Dictionary définit le « memoir » comme un « historical account », qui concerne « a public figure », le dictionnaire Merriam Webster y voit simplement « a narrative composed from personal experience », et un synonyme d’« autobiography ».
Enfin l’apport critique concernant les autobiographes du corpus de Robinson est bien mince en comparaison de l’intérêt de l’ouvrage sur le plan de l’étude générique. Nonobstant les belles pages de Robinson sur Isherwood que l’on a signalées, les chapitres sur auteur ne sont guère que des résumés des livres agrémentés de brefs commentaires. Ils ne sont d’ailleurs pas sans quelques inexactitudes et quelques affirmations contestables (par exemple l’idée que Journal du voleur commencerait comme une autobiographie – l’épisode espagnol – et s’achèverait par un regain du romanesque correspondant aux pages sur Anvers, ce qui paraît assez arbitraire : la biographie de White consacrée à Genet ne suggère pas une fiabilité autobiographique plus forte pour le début que pour la fin d’un livre qu’il est peu trop simple de ranger parmi les autobiographies).
Gay Lives. Homosexual Autobiography from John Addington Symonds to Paul Monette est donc un ouvrage qui ouvre de nombreuses perspectives critiques, à défaut d’être à proprement parler un ouvrage de critique. Robinson interroge les vies homosexuelles observées au travers des autobiographies, et non pas les expériences autobiographiques et les stratégies de récit de soi chez des auteurs s’écrivant pour dire ce qui ne s’avoue pas : l’amour qui « n’ose pas dire son nom », pour reprendre la formule de Porché. L’ironie est que Robinson s’excuse de n’être pas critique en présentant son travail comme l’ouvrage d’un historien, alors qu’il ne s’agit pas là de l’intérêt premier du livre. Ce dernier comporte sans doute les éléments d’une histoire de la vie intime des homosexuels, la manière dont ils se percevaient eux-mêmes – la lecture de Robinson, en cela pourrait être complétée par les recherches bien connues de Philippe Artières, dont l’étude sur les autobiographies criminelles inclut le témoignage de l’« hermaphrodite mental » Charles Double5, ou par celles de Clive Thomson qui a édité les archives de Georges Hérelle6 – mais Robinson ne lit pas les autobiographes de son corpus en fonction de leur contexte historique et social : malgré qu’il en ait, il ne fait pas vraiment œuvre d’historien lorsqu’il évoque la lutte de Dieu et de Satan chez Green ou la quête du compagnon idéal chez Ackerley. L’intérêt scientifique du livre ne se trouve pas là où Robinson voulait le placer : il est dans l’identification d’une catégorie littéraire. Robinson achève son ouvrage (p. 410) par l’appel au travail de « future historians » : il nous semble que cet appel devrait plutôt se diriger vers les critiques littéraires soucieux du genre autobiographique. Certes, beaucoup des impensés de l’ouvrage de Robinson ont été traités depuis – nous en avons donné quelques exemples glanés notamment dans les études gidiennes, et l’on pourrait mentionner encore le très réussi Never Say I7 de Michael Lucey, qui comble efficacement certains des manques de l’ouvrage de Robinson en interrogeant les implications énonciatives et politiques du geste littéraire consistant à écrire l’homosexualité à la première personne, mais l’ouvrage de Lucey n’est pas à proprement parler une étude de l’autobiographie, et il semble que peu de critiques se soient aventurés dans la voie d’une approche générique, ouverte par Robinson sans être vraiment conduite à son terme. Avis aux chercheurs, donc : beaucoup reste à écrire.
- 1. Sur ce point, on renverra à l’intéressant article d’Enrico Guerini, « André Gide et Julien Green. Pour une prise de parole de l’homosexualité en littérature » (dans Jean-Michel Wittamnn [dir.], Gide ou l’identité en question, Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque gidienne », 2017, p. 197-210). En s’appuyant essentiellement sur le Journal de Green, Guerini montre que Gide, avec une insistance infatigable, tente d’amener Green à écrire sur son homosexualité.
- 2. Christine Ligier, « De la notion de genre chez Gide et de quelques petits détails… », dans Pierre Masson et Jean Claude (dir.), André Gide et l’écriture de soi. Actes du colloque organisé les 2 et 3 mars 2001 par l’Association des amis d’André Gide, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2002, p. 181-197, ici p. 182.
- 3. Cameron D. E. Tolton, Gide and the Art of Autobiography, Toronto, Macmillan of Canada, 1975, p. 23.
- 4. Philippe Lejeune, Exercices d’ambiguïté. Lectures de « Si le grain ne meurt », Paris, Lettres modernes Minard, 1974, voir notamment p. 33 sq.
- 5. Philippe Artières, Le Livre des vies coupables. Autobiographies de criminels (1896-1909), Paris, Albin Michel, coll. « Bibliothèque Albin Michel Histoire », 2000, p. 283-313 ; l’expression d’« hermaphrodite mental » est celle qu’emploie Charles Double, il l’emprunte à Johann Ludwig Casper (p. 286).
- 6. Georges Hérelle, Archéologue de l’inversion sexuelle « fin de siècle », éd. Clive Thomson, Paris, Le Félin, 2014.
- 7. Michael Lucey, Never Say I. Sexuality and the First Person in Colette, Gide and Proust, Durham / Londres, Duke University Press, 2006.

