« Repenser le pacte autobiographique dans la littérature japonaise : le shishōsetsu »
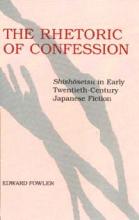
Fowler Edward, The Rhetoric of Confession. Shishōsetsu in Early Twentieth-Century Japansese Fiction, Berkeley, University of California Press, 1988.
Entre 1997 et 1998, la collection de la Bibliothèque de la Pléiade a publié deux tomes consacrés à l’œuvre de Jun’Ichirō Tanizaki, auteur japonais de renommée mondiale[1]. Cette reconnaissance de la littérature japonaise reste cependant un phénomène isolé. En 2021, aucun auteur japonais n’a rejoint la collection de la Pléiade, qui se veut le panthéon de la littérature française et mondiale. Comment expliquer ce vide ? Le Japon n’est pourtant pas en manque d’auteurs prolifiques : les noms de Haruki Murakami, de Yukio Mishima et de Kenzaburō Ōe ne sont pas inconnus des lecteurs francophones. Toutefois, le panorama de la littérature japonaise reste limité à quelques noms et, en France, rares sont les traductions d’auteurs japonais, même si ceux-ci jouissent d’une importante célébrité au Japon. Chikamatsu Shūkō et Kasai Zenzō, deux des trois auteurs dont Edward Fowler propose une étude approfondie dans The Rhetoric of Confession. Shishōsetsu in Early Twentieth-Century Japansese Fiction n’ont jamais été traduits en français. À cet égard, la présence d’un seul auteur japonais dans la Bibliothèque de la Pléiade, aussi connu soit-il, est belle et bien significative de notre méconnaissance de cette littérature. Dans un article intitulé : « Rendering Words, Traversing Cultures: On the Art and Politics of Translating Modern Japanese Fiction »[2], Edward Fowler analyse ce manque d’intérêt dans le cas des États-Unis, qui provient, selon lui, de l’importation d’un corpus d’auteurs japonais très maigre, réduisant la littérature japonaise – et par ricochet, le Japon tout entier – à un stéréotype, celui d’un pays exotique, où prédomine un rapport avant tout esthétique au monde, et défini avant tout par son opposition à l’Occident[3]. Il y a là un cercle vicieux, car tout ce qui échappe à ce canon – somme toute très réducteur – a très peu de chance de se voir publié, et encore moins lu, ce qui ne fait qu’entretenir une vision stéréotypée et dépassée de la littérature japonaise.
The Rhetoric of Confession d’Edward Fowler vise précisément à combler ce vide. Son objectif est de faire découvrir à un public ne maîtrisant pas le japonais une forme littéraire singulière, le shishōsetsu. Or ce genre défie les catégories littéraires que le lecteur occidental considère souvent comme absolues, l’obligeant à envisager la littérature et l’écriture sous un nouvel angle. Selon Fowler, le shishōsetsu, qui s’apparente aussi bien à un genre qu’à un courant littéraire – aussi Fowler privilégie-t-il le terme de « forme », plus englobant[4] – « commence à peu près avec la publication de Futon de Tayama Katai (1907), qui est généralement considéré comme le texte précurseur du shishōsetsu, et se finit [...] au milieu des années vingt » (p. xxvii). Cependant, des shishōsetsu sont encore publiés au cours des xxe et au xxie siècles. Le nom se traduit littéralement par « roman du je », shi étant la contraction de watakushi (qui est l’un des pronoms japonais signifiant je), et shōsetsu étant employé pour traduire le mot roman bien que cette appellation soit en fait inexacte. Nous y reviendrons.
Dans son ouvrage, Fowler se donne pour mission non seulement de faire connaître le shishōsetsu, mais aussi d’en expliquer les enjeux politiques et littéraires. Ainsi qu’il le souligne dès l’introduction, cette forme a à ce point marqué la littérature des ères Meiji (1868-1912) et Taishō (1912-1926) que « le critique Tetrad Toru n’a pas beaucoup exagéré lorsqu’il a déclaré en 1950 que seuls trois auteurs majeurs de la Post-Restauration (Natsume Sōseki, Koda Rohan et Izumi Kyoya) n’avaient pas écrit de shishōsetsu[5] ». Toutefois, le shishōsetsu se nourrit de paradoxes et de contradictions, à la fois formelles et pratiques, qui, aux yeux d’un lecteur occidental, paraissent insurmontables. Le shishōsetsu n’en a pas moins été extrêmement populaire, cristallisant autour de lui la plupart des débats littéraires de l’époque.
Pour définir rapidement le shishōsetsu, disons qu’il s’agit d’une forme d’« écrit de soi », où l’auteur, le narrateur et le héros se confondent en une seule identité, chargée de narrer un ou plusieurs épisodes de sa vie. Adoptant une narration par essence fictive, mais se lisant comme une autobiographie authentique et « vraie », ce « roman du je » répond donc mal à une quelconque tentative d’interprétation à partir de nos catégories de pensée. Par l’exploration de ses spécificités, The Rhetoric of Confession apporte un nouveau regard sur les questions soulevées par les « écrits de soi » et dépassent le(s) modèle(s) européen(s), fondé(s) sur une séparation entre autobiographie, Mémoires, autofiction, biographie, biographie romancée, etc.
C’est Le Pacte autobiographique de Philippe Lejeune, qui, en France, a donné à la réflexion sur écrits factuels à la première personne un cadre théorique clairement défini. Philippe Lejeune définit un cadre temporel et spatial très précis : l’autobiographie, pour lui, ne peut s’appliquer uniquement qu’à « la littérature européenne[6] » postérieure à 1770. Cette délimitation du champ littéraire lui a permis de proposer une définition de l’autobiographie, toujours en vigueur en France, comme « récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité[7] ». Or, comme nous montre depuis plusieurs années l’émergence des études de littérature étrangère et postcoloniales, mais aussi le succès du concept de « littérature mondiale », il apparaît de plus en plus urgent, sur le plan de la poétique, de refléter cette diversité voire cette hétérogénéité culturelle du paysage littéraire. Ainsi, sans chercher à remettre en cause le système de Lejeune – qui a toute sa pertinence pour le cadre défini dans les années 1970 par le critique –, il s’agit de mettre ce système en perspective avec l’étude de Fowler sur le shishōsetsu, afin de développer de nouveaux axes de réflexion, de tenter de dépasser des impossibilités sémantiques et linguistiques propres aux langues européennes, et ainsi d’ouvrir de nouveaux champs de réflexion et d’écriture.
Le shishōsetsu, une forme issue de la culture japonaise
Lorsque l’on tente de définir le shishōsetsu à partir du cadre théorique lejeunien, on se heurte à plusieurs difficultés. Car – et c’est la thèse défendue par Fowler – pour comprendre le shishōsetsu, on ne peut pas l’analyser ainsi qu’on le ferait de la littérature occidentale. Pour que le shishōsetsu fasse partie des « écrits de soi », il faut accepter de le situer au croisement de catégories littéraires pourtant considérées comme antinomiques. Les comparaisons que Fowler établit avec la littérature européenne, et plus particulièrement française, visent toutes non pas à rapprocher les deux littératures, mais à l’inverse à les différencier en raison de l’histoire culturelle et littéraire spécifique du Japon, qui n’a subi les influences de l’Europe et des États-Unis que très tardivement, au milieu du xixe siècle.
La première difficulté tient au fait que le shishōsetsu n’est pas un genre. En japonais, le terme shōsetsu désigne un texte de fiction. Il « signifie à l’origine “histoire non-officielle”, et renvoyait à des écrits populaires s’inspirant librement de récits historiques, écrits en langue vernaculaire [par opposition au chinois], ce qui révèle le peu d’estime qu’on leur accordait[8] ». Fiction et littérature renvoyaient donc à deux réalités différentes jusqu’au xixe siècle, puisque la littérature se confondait entièrement avec les écrits historiques ou « chroniques », seuls dignes d’être retenus. Nuançons toutefois sur ce point l’analyse de Fowler. En effet, comme le montre Emmanuel Lozerand dans Littérature et génie national : naissance d’une histoire littéraire dans le Japon du xixe siècle[9], parmi les textes en prose, certains textes littéraires fictifs faisaient partie du canon littéraire et possédaient autant de prestige que les écrits historiques, sur le modèle chinois. Il s’agit de la littérature féminine d’Heian, notamment Le Dit du Genji (Genji monogatari)[10], très rapidement élevé au rang de classique malgré son caractère fictif. Néanmoins, malgré quelques exceptions, les textes fictifs étaient exclus de la « littérature », c’est-à-dire la littérature haute, digne d’être retenue et transmise.
Or, avec l’ouverture du Japon au reste du monde et l’importation des littératures européennes, shōsetsu a ensuite été utilisé pour traduire le terme roman, ou novel en anglais – sans pour autant perdre son ancienne signification. Shōsetsu ne recoupe néanmoins pas tout à fait la catégorie roman. Outre l’argument précédent, alors que roman implique une certaine longueur – par opposition à la nouvelle – le « shōsetsu désigne un texte de fiction en prose de n’importe quelle taille[11] ». Bien souvent, il s’agit d’un texte relativement court, car la carrière des auteurs de shishōsetsu était directement liée à la publication de leurs œuvres dans les magazines littéraires, mais aussi parce que les textes en prose plus longs étaient considérés comme lourds et maladroits[12]. De plus, alors que la littérature occidentale considère que les essais, les Mémoires, les journaux intimes ne peuvent prendre l’appellation roman, le terme shōsetsu peut justement être utilisé pour qualifier des textes qui ne sont pas de la fiction, comme un essai[13]. C’est pourquoi Fowler préfère le terme de forme, qui rappelle que le shishōsetsu peut prendre des apparences très diverses.
Malgré tout, au Japon, le shishōsetsu est considéré dans sa forme comme un texte de fiction, puisqu’il descend des récits fictifs de l’époque d’Edo et des récits naturalistes de l’époque Meiji – certes, le naturalisme japonais s’inspire du naturalisme français, mais le résultat n’en est pas moins tout autre. Le shishōsetsu a en outre donné naissance au roman japonais moderne, ouvertement fictionnel, même si son contenu doit, quant à lui, être le plus sincère possible, et prendre une tournure autobiographique. Car pour se légitimer, le shishōsetsu n’a pas eu d’autre choix que de revendiquer sa filiation avec la littérature « noble », celle des chroniques, écrites sur le modèle chinois, qui valorisait plus que tout précisément la dimension historique[14]. Autrement dit, il s’agit de consigner des faits réels, de la manière la plus rigoureuse possible. Aussi, bien que désigné par le terme shōsetsu (qui signifie fictionnel), le shishōsetsu s’est souvent confondu avec l’autobiographie et a toujours été considéré par ses auteurs et par ses lecteurs comme de la non-fiction : seule une référentialité constante et explicite lui permettait de se faire valoir comme « vraie littérature ». Le défi du shishōsetsu est donc de donner au roman une forme sérieuse, qui se manifeste bien souvent par le développement d’une « réflexion philosophique et morale[15] ». À ce titre, Shiga Naoya (1883-1971) en offre le meilleur exemple. Aux yeux de ce dernier, l’exigence de sincérité va de pair avec une exigence d’intégrité[16], et Shiga Naoya a toujours défini son écriture « non comme la description plus exhaustive ou la plus objective possible de l’expérience vécue, mais plutôt comme la démonstration indiscutable de son intégrité morale[17] ». Fowler souligne que ce faisant, Shiga livre en réalité très peu sur lui-même, alors même qu’il se présente comme le plus sincère possible. La dimension confessionnelle, l’exigence de sincérité et l’exactitude autobiographique du shishōsetsu aurait dû contraindre l’auteur à révéler son intimité. Or Shiga ne peut s’empêcher de se créer un masque, propre à rendre l’équation auteur = narrateur = héros pour le moins problématique. Dans ses récits, celui-ci refuse, en effet, de rendre public les épisodes les moins glorieux de sa vie, au risque de créer des vides. Ne reste donc que le silence :
L’attrait pour les histoires [de Shiga Naoya] naît en grande partie de l’ingénuité couplée à un respect de la bienséance qu’affiche le narrateur-héros. Mais cette ingénuité est une façade, une technique bien étudiée, comme cela ne peut qu’être lorsque l’écriture est si peu spontanée[18].
Le cycle de Yamashina, qui comprend : Saji, (1925), Yamashina no kioku (1926), Chijo (1926) et Banshu (1926), relate la relation que l’auteur a eu avec une geisha de Kyōto, puis sa rupture après que sa femme a découvert l’affaire. Dans Chijo, l’auteur se sépare de la geisha, avant de la revoir dans Saji (écrit auparavant, qui relatant les événements situés entre Chijo et Banshu). Dans Banshu, son père vient lui rendre visite : tous deux passent du temps ensemble, ce qui empiète sur le travail de l’écrivain. Or, comme son père s’inquiète d’être responsable de son retard, Shiga, qui doit rendre un manuscrit rapidement, décide de publier un ancien manuscrit où il raconte son histoire avec la geisha. Non sans s’inquiéter des répercussions éventuelles entraînée par cette publication, étant donné qu’il n’a pas avoué à sa femme poursuivre encore sa liaison avec la geisha, ce que Saji lui révélera. Shiga met finalement un terme à sa liaison, lorsqu’une servante contacte sa femme après avoir lu Saji. Mais là où dans l’histoire, le narrateur a tout à perdre en publiant ses romans, dans la vie – Shiga ayant publié Saji en premier –, cette liaison adultère s’était achevée avant la publication des autres œuvres : aussi, n’ayant plus rien à perdre, l’écrivain avait-il décidé de tout révéler. Banshu, qui relate les raisons pour lesquelles le personnage décide de publier les volumes, apparaît donc comme une sorte de justification morale, puisque Shiga y prétend être obligé de publier ses romans afin que son père ne se sente pas responsable. De cette manière, l’écrivain « s’extirpe de la responsabilité morale (vis-à-vis de sa femme) en faisant appel à une responsabilité encore plus grande (celle vis-à-vis de son père), ce qui lui permet de rétablir son rôle d’arbitre moral même lorsqu’il est coupable d’adultère[19] ». Shiga adopte ainsi un masque, et reste silencieux sur les raisons personnelles l’ayant poussé à la fois à entreprendre puis interrompre cette liaison, mais aussi à la publier.
Malgré ces écarts de confession, le shishōsetsu présente toutefois les caractéristiques principales de l’autobiographie, telle que définie par Lejeune, à savoir l’identité héros-narrateur-auteur, liée à un pacte plus ou moins explicite noué entre auteur et lecteur, qui engage le premier à relater sa stricte expérience :
La question de la « présence » de l’auteur dans le texte a eu une très grande importance dans la littérature japonaise, puisque la seule présence de l’auteur suffisait à établir l’« authenticité » du texte (c’est-à-dire sa pureté autobiographique ou sa non-fictionnalité), ce qui était la qualité la plus noble que pouvait offrir l’écriture[20].
Chaque œuvre est lue comme renvoyant forcément à la vie de l’auteur. À ce titre, Futon de Tayama Katai est considéré comme le texte précurseur du shishōsetsu, à la fois du fait de sa dimension autobiographique et parce qu’il peint un portrait très négatif du héros. Bien que le nom du héros ne soit pas le même, l’identité de personne entre auteur, narrateur et héros est bien réelle. Ici, selon Fowler, on s’écarte de l’autobiographie en raison du décalage nominal entre l’auteur et le héros, critère essentiel aux yeux de Lejeune en 1975, mais sur lequel le poéticien est revenu en 1983[21]. Futon est l’histoire de Takenata Tokio, un écrivain d’une quarantaine d’années, marié, qui accepte de prendre pour élève une jeune fille, Yoshiko. Cette dernière est non seulement très belle, mais c'est en plus l’exacte opposée de son épouse. Takenata Tokio tombe amoureux de Yoshiko, et rêve de réécrire sa vie avec elle. Il apprend toutefois que celle-ci a un petit ami, et se sentant trahi et jaloux, révèle au père de la jeune fille sa relation avec le jeune homme, causant la fureur paternelle et le départ de Yoshiko forcée de rentrer chez ses parents. Factuellement, l’histoire ressemble en tout point à la vie réelle de Tayama. Mais il importe finalement peu de savoir si Tayama éprouvait les mêmes sentiments que le héros vis-à-vis de Yoshiko. En revanche, plus intéressant, ainsi que le souligne Fowler, est le fait que la critique littéraire n’ait jugé ce texte qu’en fonction de sa référentialité, et se soit divisée en deux camps : ceux qui y voyait une peinture exacte des sentiments de l’auteur, et ceux qui considéraient que Katai avait fortement fictionnalisé ses sentiments. Il se trouve que cette conception étroitement factuelle est secondaire pour Lejeune, puisque le pacte autobiographique repose sur une conception rousseauiste du sujet, où la conformité stricte à la vérité importe moins que la vérité du sujet garantie par l’acte de sincérité même, autrement par le pacte. On le voit, la littérature japonaise accorde pour sa part une plus grande importance à la stricte adéquation entre faits réels et récit de ces faits, et en cela, le shishōsetsu présente les caractéristiques de l’autobiographie tout en en différant.
Fowler affirme que le shishōsetsu ne peut pas être considéré comme une autobiographie car il ne suit pas à proprement parler le fil « dynamique d’une narration, si étrangère à l’esthétique traditionnelle japonaise[22] ». En effet, la plupart des shishōsetsu se caractérisent par un refus d’une quelconque dynamique de progression : l’action y est inexistante, ou est dénuée d’intérêt, ou encore effectue un mouvement cyclique de retour sur soi-même. Revenons au système de Philippe Lejeune : ce n’est pas tant l’absence de progression qui y est rédhibitoire pour définir une autobiographie, mais plutôt le refus du récit rétrospectif. Et les auteurs de shishōsetsu cherchent justement à l’éviter, le héros-narrateur-auteur devant toujours parler du présent, où depuis un passé le plus proche possible (même si ce présent-passé est bien plus vieux). Comme le shishōsetsu se définit par son absence de rétrospection, « souvent, il se lit davantage comme un journal intime[23] ». Sur ce point, Chikamatsu Shūkō va le plus loin dans le refus de rétrospection, en abolissant toute distance entre le temps du récit et celui de l’écriture. Dans le cycle « Estranged Wife[24] » (1910-1905), divisé en quatre parties : Wakaretaru tsuma ni okuru tegami, Shujaku, Giwaku, et Giwaku zokuhen,
le narrateur-héros se narre tel un homme perdu dans le fiasco de sa vie émotionnelle […], emporté par les flammes de la passion et incapable de distance critique ou ironique. Peu importe que Shūkō écrive généralement des mois ou des années après les faits. Il parvient toujours à effacer la distance entre la narration et les faits[25].
Pour cela, l’auteur emploie le modèle de la correspondance, adressée à sa femme, et renverse la narration, débutant l’histoire alors que le héros est au sommet de sa passion. Ce cycle raconte la tentative ratée de Shūkō pour reconquérir sa femme, dont il est éperdument amoureux, mais partie avec un autre homme. Sans nouvelles d’elle, ne sachant même pas où elle se trouve, le narrateur raconte, lettre après lettre, les mêmes événements, mais ses lettres restent sans réponse. Ces répétitions, d’un texte à l’autre, renforcent l’impression que rien ne se passe. À la fin, le narrateur n'en sait pas plus qu’au début de l’histoire : factuellement, rien n’a changé.
Influence du langage sur le shishōsetsu
Fowler accorde une grande partie de son analyse à la question du sujet, et au rapport que le sujet entretient avec le monde. C'est sur ce point que, selon lui, se concentrent les différences avec la littérature occidentale. Pour le critique, la spécificité du shishōsetsu concerne moins son obsession du réel que la manière dont se construit le discours, autrement dit la manière dont la langue conditionne les représentations[26].
L’un des principaux éléments distinctifs entre langues européennes et japonais tient à l’usage des pronoms je, tu, il. La langue japonaise dispose de plusieurs pronoms pour désigner la première personne, dont aucun n’est aussi général que notre je, puisque chaque je en japonais se comprend dans la relation que l’énonciateur entretient avec son interlocuteur. Watashi, dans un contexte formel, peut être employé par des hommes ou des femmes. Dans un contexte informel, avec des amis par exemple, watashi est généralement réservé aux femmes. Watakushi est la forme la plus formelle – ou la plus polie –, et est réservée aux situations professionnelles. Boku et ore sont utilisés par les hommes, souvent dans un contexte informel – de manière très schématique, boku évoque une certaine forme de masculinité, de force, tandis qu’ore est plus doux, plus réservé. Uchi est plutôt utilisée par les femmes, mais peut être employé par des hommes dans certaines occasions. Atachi est employé par les femmes, préférablement à l’oral. Jibun est employé sans différence de genre, et peut susciter une impression de distance. Bien évidemment, cette liste n’est pas exhaustive : il existe une multitude d’autres pronoms ; tout dépend de l’âge, du genre et de la situation de l’énonciateur. Autrement dit, pas de je sans un rapport à autrui. Et il en va de même pour les autres personnes. Le second point concerne la fréquence avec laquelle le pronom il, kare, est employé pour désigner le héros – qui, rappelons-le, est aussi le narrateur et l’auteur :
[K]are a une dénotation bien plus stricte dans la littérature Meiji et Taishō : il renvoie spécifiquement au protagoniste, au travers duquel le narrateur voit et pense. En effet, ce qui semble être un pronom, un élément de substitution pour n’importe quel sujet du discours, doit en fait se penser plus exactement comme un véritable nom, car l’utilisation de kare est restreinte à un seul personnage[27].
Kanashiki chichi, premier shishōsetsu de Kasai Zenzō, décrit l’histoire d’un poète vivant dans la misère, Kasai lui-même, qui a envoyé sa femme et ses enfants à la campagne pour se consacrer exclusivement à l’écriture, mais aussi parce qu’il ne peut subvenir à leurs besoins. Le nom et le prénom du héros sont inconnus, l’auteur-narrateur employant uniquement kare pour désigner le héros. Mais comme le rappelle Fowler,
ce qui, au premier abord, semble être le pronom il, qui pourrait se substituer à n’importe quel autre nom, doit être plus exactement compris comme un vrai nom, avec tout ce qu’il implique de singulier. Kare fait uniquement référence au héros et jamais aux autres personnages, et sa perception recouvre celle du narrateur[28].
C’est cet emploi d’un pronom à la troisième personne renvoyant à la fois au héros, au narrateur et à l’auteur qui rend le shishōsetsu fondamentalement différent de l’autobiographie. Or, selon la définition lejeunienne, l’autobiographie autorise l’usage de la troisième personne (ou de la deuxième) sans que cela interdise strictement l’équation auteur = narrateur = héros. En pratique, les cas sont rares, et relèvent souvent du roman autobiographique – citons Enfance de Nathalie Sarraute[29], où deux voix narratives se mêlent, l’une à la première personne et une autre à la deuxième. La position de Fowler présente un intérêt : alors que le il, selon Lejeune, est souvent employé pour marquer une distance vis-à-vis de celui que le narrateur-auteur a été, dans le shishōsetsu, l’absence de récit rétrospectif et la volonté d’être sincère sont si grandes qu’elles effacent tout autre procédé de mise à distance, même vis-à-vis de soi[30].
Les implications de cette conception du sujet grammatical sont nombreuses sur la manière dont le sujet se construit dans la société japonaise. Elle rend en effet l’idée de sujet singulier, existant pour soi, plus ou moins inconcevable. Bien que le shishōsetsu semble faire l’apologie du « moi », le but est en réalité tout autre : « Dans un contexte japonais, l’achèvement de l’identité du sujet signifie en fait, d’une manière positive, la perte de l’individualité. C’est un thème récurrent dans beaucoup de shishōsetsu[31]. » Cela se traduit notamment par « un retrait calculé de la société, qui aboutit souvent à l’identification du héros avec la nature[32] ». Par exemple, dans « Kinosaki nite » (A Kinosaki[33]) de Shiga Naoya, le héros se retire dans un célèbre onsen (spa) sur la côte japonaise après un accident. Là-bas, isolé des autres hommes, il est témoin de la mort de plusieurs animaux, ce qui l’amène à réfléchir sur sa propre existence, en « s’identifiant à un degré extraordinaire avec les forces de la nature, dont l’essence même nie l’ego ; il vit alors quelque chose qui s’apparente à une dissolution du moi […], où la vie n’est plus opposée à la mort[34]. » Au Japon, cette foi dans ce qu’on pourrait appeler un « nihilisme positif » vient du courant bouddhiste : « le bouddhisme a pour but de libérer l’homme de l’illusion d’un “moi” autonome et de le détacher de tous les liens qui l’attachent au monde[35] ». Même la littérature moderniste occidentale du « courant de conscience », en cherchant à briser l’illusion de réel imposée par la narration romanesque, ne fait bien souvent que renforcer la toute-puissance de l’individu.
Mais la grammaire japonaise produit aussi d’autres effets. Certaines expressions japonaises : to omoimasu ou to omoinagara, employées dans le langage courant, servent à souligner que l’avis ou la déclaration énoncée auparavant est un avis personnel. Littéralement, cela se traduit par : « (je) pense que » (to omoismasu). Dans cette expression, le verbe est au présent et le sujet est génralement sous-entendu, mais, comme le montre Amira Zegrour dans « La place du narrateur dans la temporalité nocturne d’un Bleu presque transparent[36] » : « il n’y a aucune ambiguïté : il ne peut s’agir que de je » car to omoimasu se définit comme une pensée que seul le sujet pensant peut entendre. Lorsque ces tournures sont employées dans un récit, elles sont souvent traduites par : « je pensais, je disais » ou « il pensait, il disait ». Le traducteur emploie généralement le passé et ajoute un sujet. Or, là où ces termes, en anglais comme en français, créent une impression de distance entre narrateur et personnage, en japonais, ils peuvent relever du discours direct et donc ne brisent pas l’illusion d’un discours immédiat. Ainsi,
les caractéristiques essentielles du discours indirect [represented speech], c’est-à-dire les changements de temps et d’usage du pronom sont introuvables. La phrase japonaise fait précisément ce que son équivalent anglais ne peut pas faire : « représenter » le discours ou les pensées d’un personnage en imitant les pensées/paroles de ce même personnage[37].
Le shōsetsu et le shishōsetsu recourent souvent à cette construction verbale. Fowler prend pour exemple La Porte (mon) de Natsume Sōseki, écrit en 1911, qui est un shōsetsu. La phrase « Tama no nichiyobi ni ko shite yukkuri sora o miageru dake demo, daibu chigau na to omoinagara » traduite dans la version anglaise par « It made quite a difference, he reflected, to be able on an occasional Sunday to gaze leisurely at the sky like this[38] », ou « Il se disait que cela faisait une grande différence d’avoir le loisir, lors d’un rare dimanche, d’admirer ainsi le ciel[39] » n’est pas exacte : elle produit un effet de distance. On devrait plutôt traduire par : « It makes quite a difference[40] » ou « Ça fait une grande différence d’avoir le loisir, lors d’un rare dimanche, d’admirer ainsi le ciel[41] ! » L’emploi de cette expression – to omoimasu – crée « un style hybride, qui rejette une narration dépersonnalisée, possédant plusieurs points de conscience[42] », comme c’est souvent le cas dans la littérature occidentale, au profit d’une toute-puissance de la voix unique du héros de (shi)shōsetsu. La médiation opérée par la narration semble s’effacer. Cela fait partie des effets relatifs à la grammaire japonaise qui créent ce que Fowler nomme le « written reportive style[43] », terme qui n’a pas d’équivalent en français – et pour cause ! – mais qui pourrait se traduire par « style direct écrit ». Ce dernier comprend en plus l’usage – ou l’absence d’usage – de pronoms, qui répond aux règles particulières évoquées plus haut. Le « style direct écrit » cherche donc à retranscrire le langage de la pensée de la manière la plus transparente possible. Autrement dit, la médiation opérée par le langage écrit tend à disparaître dans le shishōsetsu. Ce phénomène n’est d’ailleurs pas exclusif aux shishōsetsu, puisqu’on le retrouve aussi dans les shōsetsu, et dans d’autres formes littéraires. Le shishōsetsu, en tant que fiction autobiographique, non-rétrospective mais authentique, semble beaucoup plus plausible si l’on considère que la narration fictionnelle est capable de supprimer la médiation qu’elle opère pourtant ! De plus, l’autre effet produit par le « written reportive style » correspond au refus de définir explicitement un lecteur, donc au refus de matérialiser cette distance entre auteur-narrateur-héros d’un côté, et le public auquel ce dernier s’adresse de l’autre. La parole du héros, omniprésente, domine la narration. D’où le format des confessions, selon Fowler : l’absence de discours rétrospectif oblige le narrateur à ne s’adresser qu’à lui-même. Shiga Naoya, dans toutes ses narrations, choisit d’ailleurs explicitement de se parler à lui-même, ce qui lui permet d’abolir toute rétrospection. C’est justement parce que Dazai Ozamu multiplie les points de vue de son je dans La Déchéance d’un homme[44] (Ningen shikkaku) à travers une longue analepse temporelle encadrée par l’incipit et la fin, qui semble favoriser un regard objectif du je âgé sur le je plus jeune, que de nombreux critiques ont refusé de qualifier son livre de shishōsetsu.
Dans ce repli de l’auteur sur lui-même, on retrouve ainsi pour partie une forme de scepticisme à l’égard du roman occidental, notamment en raison de la fictionnalité de ce dernier. Créer une intrigue, une histoire avec un fil narratif, paraît beaucoup trop étranger, trop éloigné du réel pour un écrivain japonais. Il n’est donc pas étonnant que le shishōsetsu se concentre sur la figure de l’auteur et favorise une lecture autobiographique. Cela a souvent eu pour effet de modifier, voire d’abolir l’intrigue narrative : en considérant que le monde ne peut exister que lorsqu’il est vécu à travers les yeux d’un sujet, et que l’imagination n’a pas sa place, la pensée japonaise adopte en fait une perspective à bien des égards épistémologique, ce que souligne la célèbre déclaration d’Iwano Homei, critique japonais, dans « Gendai shosetsu no byosha ho » (1911) à propos de Futon de Katai : « Il n’y a pas de vie en dehors de soi[45] », par conséquent, « l’auteur ne peut espérer peindre fidèlement la vie s’il se coupe de sa propre subjectivité[46] ». Cette perspective épistémologique est de fait revendiquée par les écrivains et les critiques japonais, et les élites littéraires de l’ère Taishō ont par la suite repris la formule d’Homei, en lui donnant un sens encore plus strict : l’auteur ne peut qu’écrire sur lui-même. À cela s’est ajouté, comme le souligne Fowler, la pression politique du gouvernement de Meiji qui a pesé sur ces choix de représentation, la censure obligeant les écrivains à écrire sur des sujets non polémiques, et, à ce titre, leur vie personnelle était le thème idéal.
Le shishōsetsu peut-il échapper à la fiction ?
À partir du moment où un auteur décide d’écrire, il passe d’un médium à un autre. Dans le cas de l’écrivain de shishōsetsu, il passe de son expérience, médiatisée par ses cinq sens, à un texte, médiatisé par l’écriture. Un tel passage implique une transformation (voire une fictionnalisation ?) : la représentation littéraire contraint à reconstituer, ne serait-ce que parce qu’il est impossible de rendre une image, une odeur, un son tel qu’on l’a perçu, autrement dit à faire un tri dans l’expérience vécue. Ce faisant, l’écrivain donne plus ou moins de valeur à des épisodes de sa vie, crée une trame narrative nouvelle, et confère une cohérence artificielle aux événements vécus. La représentation littéraire peut certes être le reflet du réel, mais elle ne permet pas de faire advenir l’expérience même du réel.
De fait, les écrivains japonais du shishōsetsu sont régulièrement aux prises avec cette nécessaire reconstitution qu’implique leur œuvre : il est en effet difficile, malgré les perspectives offertes par le « written reportive style » japonais, d’abolir la représentation littéraire. Or la critique littéraire de l’époque a tout fait pour mystifier le concept d’« authenticité » : non seulement l’auteur ne doit pas inventer des épisodes de sa vie s’il veut écrire un shishōsetsu – en pratique, nombreux sont pourtant ceux qui le font, s’exposant souvent par la suite aux critiques –, mais il ne peut reconnaître que la représentation littéraire est autre chose qu’une fenêtre transparente permettant d’accéder directement à l’expérience de l’auteur. Ce mythe, qui donne au shishōsetsu une aura unique, transforme de fait ce genre en « un artefact culturel (et non pas seulement littéraire)[47] » qui représente l’ensemble de la culture japonaise, rendant ainsi plus difficile d'envisager une analyse de la représentation littéraire dans le shishōsetsu.
Selon Fowler, ce mythe de la sincérité est entretenu par deux facteurs : les cercles littéraires japonais, dit bundan, et la place de l’auteur dans la société japonaise. La publication systématique de shishōsetsu dans les journaux, dont le prestige pouvait être immense[48], a encouragé la constitution d’une littérature centrée sur de petits cercles de sociabilité littéraire, les bundan. Or cette proximité entre auteurs faisait qu’il était facile de vérifier les faits énoncés dans chacun des shishōsetsu. De même les auteurs jouissaient à cette époque d’un statut de quasi-célébrité. « Que sa vie “privée” (voyages, adresses d’hôtels) soit aussi digne d’intérêt que sa vie “professionnelle” (écriture, projets d’œuvres) nous rappelle une fois de plus de la tendance générale de l’époque à confondre les deux[49]. » La vie privée des écrivains japonais est, de fait, quasiment inexistante, au contraire de leurs homologues européens. On peut néanmoins regretter que Fowler ignore certains cas particuliers, tels Johann Wolfgang von Goethe ou Jean-Paul Sartre, qui furent l’un et l’autre de véritables célébrités à leur époque[50]. Les raisons de la popularité de Sartre sont multiples, et ne font pas toujours consensus auprès des spécialistes ; notons toutefois quelques pistes : le succès de L’Être et le Néant (vulgarisé par sa célèbre conférence : L’existentialisme est un humanisme), dont les enjeux philosophiques trouvent un écho dans la génération d’avant-guerre mais aussi dans celle de l’après-guerre, son effort conscient pour s’adresser au grand public et prendre position sur des enjeux sociaux et politiques, la curiosité qui entoure le couple qu’il forme avec Simone de Beauvoir…
Mais même si le shishōsetsu possède une dimension proche d’une fictionnalisation, il n’en constitue pas moins une « forme » hybride du point de vue occidental, qui ne coïncide pas tout à fait avec l’autofiction, précisément parce qu’elle est avant tout préoccupée de la fidélité au réel, jusque dans le langage, là où Doubrovsky revendique fictionnalité inhérente au langage :
Fiction, d’événements et de faits strictement réels ; si l’on veut, autofiction, d’avoir confié le langage d'une aventure à l’aventure du langage, hors sagesse et hors syntaxe du roman, traditionnel ou nouveau. Rencontres, fils des mots, allitérations, assonances, dissonances, écriture d’avant ou d’après littérature, concrète, comme on dit musique[51].
Cette obsessiu du shishōsetsu pour l’exactitude des faits et la transparence de la représentation, entraîne de nombreuses contradictions, qui en menacent constamment l’existence, et que Fowler rappelle tout au long de son essai. De cela, les auteurs ne sont pas dupes. Ces paradoxes ont pour effet de rendre plus intéressantes encore ces œuvres, soit parce que les auteurs choisissent de se confronter plus ou moins directement à l’impossibilité de mettre en pratique la théorie qu’ils ont créée, soit parce qu’ils tentent d’écrire en évitant de s’y confronter. Ces paradoxes, nous les avons déjà évoqués : la non-concordance entre faits réels et relatés et l’adoption d’un masque, d’une persona. Selon Fowler, c’est « le mensonge de la “présence” auctoriale dans le style rapporté[52] » qui en est à l’origine :
De ce style est né le mythe de la « sincérité ». […] Le style rapporté s’est révélé être indissociable de la fiction : les auteurs ont réalisé que le simple fait de s’exprimer, impliquait forcément d’adopter un masque, de remplacer la personne par la persona[53].
Or les auteurs de shishōsetsu, s’ils tentent de camoufler les contradictions qui naissent de la représentation littéraire, en ont néanmoins une conscience aiguë, probablement parce qu’ils doivent s’efforcer de la faire disparaître afin que leur récit soit perçu comme « vrai ». Comme le montre Fowler, cette conscience des limites de la représentation littéraire ne doit pas être confondue avec les préoccupations littéraires modernistes et « post-modernes » du Nouveau Roman en France ou du courant de conscience dans le monde anglo-saxon. Alors que les premiers refusent le mythe de la sincérité au profit de l’innovation formelle (Les Gommes de Robbe-Grillet) et placent cette recherche au centre de leurs œuvres, les auteurs du shishōsetsu jouent plutôt avec la représentation littéraire, sans jamais reconnaître ouvertement sa nature fictive. À ce titre, à considérer toute l’œuvre de Tayama Katai, celle-ci tourne exclusivement autour du « motif de l’amour interdit ». Cela concerne aussi bien ses shishōsetsu que ses shōsetsu. On a donc affaire moins à un trait de personnalité qu’à la construction d’un thème littéraire spécifique : ses héros sont tous identiques et les jeunes filles se ressemblent toutes. Ces dernières sont extraverties, cultivées, et surtout sont très belles. Dans Futon comme dans Onna kyoshi, le héros est un homme d’âge mûr, qui espère trouver une sorte de seconde jeunesse dans l’amour qu’il porte à une jeune fille. La structure des textes est également très similaire. Il semble donc que l’intérêt de l’œuvre soit moins la dimension autobiographique ainsi que les contemporains l’ont cru, que la manière dont se décline un tissu littéraire spécifique à l’œuvre de Tayama Katai.
Mais c’est Kasai Zenzō qui pousse le mythe de la sincérité dans ses retranchements les plus profonds : au lieu de cacher la fictionnalité du texte, celui-ci ne cesse
d’exhiber l’illusion qui fait du texte une expression spontanée, une forme toujours et déjà finie. Paradoxalement, cette mise en relief de l’illusion ne fait pas pencher le texte du côté de l’irréel ou du fantastique ; attirer le regard sur le cadre renforce le réalisme. Le lecteur est plus facilement happé par la conscience du narrateur : la sincérité qui fait avouer le « cadre » implique que le « contenu » est forcément authentique[54].
Dans Nakama, le narrateur interrompt son récit pour faire part de ses difficultés à écrire. De plus, à chacun de ces récits, l’auteur plonge de plus en plus dans la folie, ses textes devenant de plus en plus discontinus, tant sur la forme que sur le fond. Ses deux derniers livres, Jakusha et Suikyosha no dokuhaku, qui peignent sa vie d’alcoolique, alité et malade, « du fait de leur narration et de leur thématique turbulente, représentent de manière très graphique, à la fois le sommet et les limites du shishōsetsu[55] ». Dans Suikyosha no dokuhaku, le héros, incapable de savoir s’il est fou ou simplement malade, perd confiance dans sa lucidité. Devoir se reposer sur la perception que les autres ont de lui pour écrire sa propre histoire le dépouille petit à petit de son identité, et l’entraîne dans les confins de la folie, dont la narration se fait le reflet.
***
The Rhetoric of Confession propose une analyse approfondie du shishōsetsu, à destination d’un public ne parlant pas le japonais. La qualité des analyses, la quantité des textes et les connaissances relatives aux auteurs abordés sont impressionnants. Or, depuis la parution de ce livre en 1988, l’état de la littérature sur le sujet n’a que timidement évolué et l’ouvrage de Fowler n’a eu, semble-t-il, qu’un lectorat limité. Il est toutefois essentiel de mentionner la réflexion que Philippe Forest a consacrée au « roman du je » et à l’autofiction. Ayant vécu au Japon, Forest a été profondément influencé par la littérature japonaise, notamment par les écrivains du xxe siècle[56]. Sa réflexion sur l’autofiction, et plus particulièrement ce qu’il nomme le « roman du je », est donc fortement nourrie par le shishōsetsu[57], en particulier par la manière dont les écrivains japonais conçoivent le je, un je qui, comme nous l’avons dit, bien qu’omniprésent, ne vise qu’à sa propre disparition. Philippe Forest se situe finalement au croisement de deux philosophies du sujet : occidentale et japonaise, et considère que tout écrit, même autobiographique, devient une fiction, du seul fait de « la nature romanesque de l’ouvrage[58] » mais que « le je engagé dans le processus d’écriture, s’il s’éprouve comme fictif, cherche aussi, et surtout finalement, à disparaître pour laisser place, autant que possible, aux surgissements imprévus du réel »[59].
Dans le cadre des « écrits de soi », le shishōsetsu est un cas très intéressant, propre à remettre en cause l’apparente évidence des divisions de genre et des possibilités de narration. En plaçant en regard la grille de lecture de Lejeune, pierre de touche des études sur les « écrits de soi », avec le shishōsetsu, nous sommes à même de mieux comprendre ce que cette autre conception du récit autobiographique apporte à une réflexion sur ce vaste domaine de la non fiction et permet, en contrepartie, de donner à ce genre peu connu un plus grand écho au sein du canon littéraire mondial.
[1] Junichirô Tanizaki, Œuvres, Paris, Gallimard, coll. « Pléiade », t. 1 et 2, 1997-1998.
[2] Edward Fowler, « Rendering Words, Traversing Cultures: On the Art and Politics of Translating Modern Japanese Fiction », The Journal of Japanese Studies, vol. 18, n° 1, hiver 1992, p. 1-44.
[3] À ce sujet, voir Jun’Ichirō Tanizaki, Éloge de l’ombre, Paris, Publications Orientalistes de France, 1977, ou Ian Littlewood, The Idea of Japan, Western Images, Western Myths, Londres, Secker & Warburg, 1996.
[4] Edward Fowler, The Rhetoric of Confession. Shishōsetsu in Early Twentieth-Century Japansese Fiction, Berkeley, University of California Press, 1988.
[5] « […] the critic Tetrad Toru did not exaggerate a great deal when he declared in 1950 that only three major post-Restoration authors (Natsume Soseki, Koda Rohan, and Izumi Kyoka) had written no shishōsetsu. » (Ibid., p. xvi, traduction personnelle).
[6] Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 1975, p. 13.
[7] Ibid., p. 14.
[8] « […] originally meant “unofficial history” and referred to popular, loosely historical accounts written in the vernacular) is indicative of the low esteem in which it was held » (Fowler, The Rhetoric of Confession, op. cit.., p. 22, traduction personnelle).
[9] Emmanuel Lozerand, Littérature et génie national : naissance d’une histoire littéraire dans le Japon du xixe siècle, Paris, Les Belles-Lettres, coll. « Japon », 2005.
[10] Murasaki Shikibu, Le Dit du Genji, trad. René Sieffert, Paris, Verdier, 2011.
[11] « In the first place, shosetsu refers to a prose fiction of any length. » (Fowler, The Rhetoric of Confession, op. cit., p. 4, traduction personnelle).
[12] Ibid., p. 142.
[13] « […] shōsetsu can refer to texts that westerners ordinarily do not think of as fiction. Essays, sketches, memoirs, and other discursive and reflective pieces, which we would normally subsume under the rubric of nonfiction, very often fall under the category of shōsetsu in Japanese. » (Ibid., p. 4, traduction personnelle).
[14] Ibid., p. 21.
[15] « [...] a “serious” form of moral and philosophical inquiry [...]. » (Ibid., p. 74, traduction personnelle).
[16] Ibid., p. 188.
[17] « Shiga’s purpose as a shishōsetsu writer was never the complete, unerring depiction of lived experience, but rather the authoritative demonstration of his moral integrity. » (Ibid., p. 188-189, traduction personnelle).
[18] « The great attraction of Shiga's stories is the narrator-hero's display of candor and decorum. But this candor is a facade, a studied technique, as it perhaps must be in such an unspontaneous form of expression as writing. » (Ibid., p. 194, traduction personnelle).
[19] « Thus, by extricating himself from one moral responsibility (to his wife) by appealing to a higher one (to his father), he reasserts his role as moral arbiter even when he is guilty of philandering. » (Ibid., p. 202, traduction personnelle).
[20] « The question of an author's “presence” in the text has assumed great importance in Japanese letters, as it alone is believed capable of establishing the text's “authenticity” (that is, autobiographical purity or nonfictionality), the highest value attached to writing. » (Ibid., p. 7, traduction personnelle).
[21] Philippe Lejeune, « Le pacte autobiographique (bis) », Poétique, n° 56, 1983, cité dans « Qu’est-ce que l’autofiction ? », Joël Zufferey, L’Autofiction : variations génériques et discursives, Louvain-La-Neuve, Academia, 2012, p. 5-14, disponible sur Fabula, <https://www.fabula.org/atelier.php?L%27autofiction#_ftn1>.
[22] « […] for autobiography houses the same narrative dynamo that is so alien to the traditional Japanese aesthetic » (Fowler, The Rhetoric of Confession, op. cit., p. xxii, traduction personnelle).
[23] « Supposedly a fictional narrative, it often reads more like a private journal. » (Ibid., p. xvi, traduction personnelle).
[24] Nous avons choisi de conserver le nom que Fowler donne à ce cycle, parce qu’il ne porte pas de titre en japonais, et parce qu’il n’existe pas de traduction française de ce cycle.
[25] « the narrator-hero indeed recounts like a man possessed the fiascos in his emotional life […], he is caught up in a storm of passion and incapable of an ironic or critical perspective. No matter that Shuko typically wrote of an event months or years after the fact. He manages to close the gap between narrative present and story time. » (Ibid., p. 155, traduction personnelle).
[26] Ibid., p. xx.
[27] « […] kare has a far more circumscribed denotation in Meiji and Taisho literature: specifically, the protagonist, through whose eyes the narrator sees and through whose mind the narrator thinks. Indeed, what appears to be a pronoun, a placeholder for any subject of discourse, is in fact more correctly thought of as a proper name, because the use of kare is restricted to a single character. » (Ibid., p. 36, traduction personnelle).
[28] « […] what appears at first glance to be a pronoun (“he”), a placeholder for another signifier, is more correctly thought of as a proper name with all the specificity that term implies. Kare refers only to the hero and to no other male character and his range of perception overlaps that of the story's narrator. » (Ibid., p. 254, traduction personnelle).
[29] Nathalie Sarraute, Enfance, Paris, Gallimard, coll. « Blanche », 1983.
[30] Au sujet de kare et de l’utilisation de la troisième personne du singulier dans les récits autobiographiques, lire Barbara Mito Reed, « Chikamatsu Shuko: An Inquiry into Narrative Modes in Modern Japanese Fiction », Journal of Japanese Studies, t. 14, n° 1, 1988, p. 59-76, disponible sur Jstor <https://doi.org/10.2307/132531>.
[31] « The achievement of selfhood in the Japanese context, then, means in a very positive sense the loss of one's individuality. This is a recurrent theme in many shishōsetsu. » (Fowler, The Rethoric of Confession, op. cit., p. 14, traduction personnelle).
[32] « The Japanese, however, have been less convinced of (we might even say they have been uninterested in) the self's tangibility or value […] a studied withdrawal from society and often leading to the hero's identification with nature. » (Ibid., p. 13, traduction personnelle).
[33] Shiga Naoya, A Kinosaki, Marc Mécréant (trad.), Arles, Picquier, 1998.
[34] « Identifying to an extraordinary degree with the ego-denying forces of nature, he experiences something akin to total self-dissolution [...] in which life is no longer opposed to death. » (Fowler, The Rhetoric of Confession, op. cit., p. 223, traduction personnelle).
[35] « […] Buddhism aims at liberating him from the illusion of an autonomous self and releasing him from all worldly bonds. » (Ibid., p. 82, traduction personnelle). À ce sujet, lire le philosophe Nishitani Keiji, Religion and Nothingness [Shūkyō to wa Nanika, 1961], Berkeley, University of California Press, 1982.
[36] Amira Zegrour, « La place du narrateur dans la temporalité nocturne de Bleu presque transparent », Écriture de soi-R, n° 1, Nocturnes, octobre 2021, disponible à <https://www.ecrituredesoi-revue.com/nocturnes>.
[37] « The Japanese sentence, in short, is doing precisely what the English version cannot do: “representing” a character's speech or thought by imitating that character's very own words/thoughts. » (Fowler, The Rhetoric of Confession, op. cit., p. 37, traduction personnelle).
[38] Ibid, p. 36.
[39] (Traduction personnelle).
[40] Ibid.
[41] (Traduction personnelle).
[42] « […] a hybrid style that rejects depersonalized, multi-consciousness narration […] » (Ibid., p. 38, traduction personnelle).
[43] Ibid.
[44] Dazai Ozamu, La Déchéance d’un homme, trad. Georges Renondeau, Paris, Gallimard, coll. « Connaissance de l’Orient », 1990.
[45] « There is no life outside the self » (Fowler, The Rhetoric of Confession, op. cit., p. 124, traduction personnelle).
[46] « A writer cannot hope to portray life conscientiously if he cuts himself off from his own subjectivity. » (Ibid, p. 125, traduction personnelle).
[47] « If we find that Japanese writers were more linguistically than critically attuned to the nature of fictionality and referentiality, it is because the shishosetsu had so thoroughly established its own legitimacy as a cultural (and not simply as a literary) artifact. » (Ibid., p. 42, traduction personnelle).
[48] Ibid., p. 129.
[49] « That his “personal” life (e.g., travels, boardinghouse addresses) was just as newsworthy as his “professional” life (e.g., writing, publication plans) reminds us once again of the general disinclination to distinguish between the two. » (Ibid., p. 137, traduction personnelle).
[50] Au sujet de Jean-Paul Sartre, lire Ingrid Galster (dir.), La Naissance du « phénomène Sartre ». Raisons d’un succès 1938-1945, Paris, Seuil, 2001. Pour Goethe, lire Jean Lacoste, « Goethe en grand homme. », Romantisme, n° 100, « Le Grand Homme », 1998, p. 115-129, disponible sur Persée, URL : <www.persee.fr/doc/roman_0048-8593_1998_num_28_100_3294>.
[51] Serge Doubrovsky, Fils [1977], Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2001, p. 10, cité dans « Qu'est-ce que l’autofiction ? », Zufferey, art. cité.
[52] « […] the lie of authorial “presence” featured in the written reportive style. From this style has sprung the myth of “sincerity” [...] » (Fowler, The Rhetoric of Confession, op. cit., p. 41, traduction personnelle).
[53] « The written reportive style turned out not to be fiction-free: the very act of expressing themselves in writing, they realized, was in effect to don a mask, to supplant person with persona. » (Ibid., traduction personnelle).
[54] « Rather than suppress the process of literary production, he exposes the illusion of the text as spontaneous expression, as an always and already finished form. Paradoxically, such foregrounding does not push the narrative in the direction of the surreal or fantastic; calling more attention to the frame actually heightens the sense of reality. The reader is easily taken in by the narrator's casual self-consciousness: the professed sincerity of the “frame” implies an authenticity of “content.” » (Ibid., p. 261, traduction personnelle).
[55] « […] because of their thematic and narrative turbulence, represent most graphically both the culmination and the limits of the shishōsetsu form. » (Ibid., p. 281, traduction personnelle).
[56] Philippe Forest, Sarinagara, Paris, Gallimard, 2004.
[57] Id., Le Roman, le je, Nantes, Pleins Feux, 2001 et Philippe Forest, Le Roman, le réel et autres essais (Allaphbed 3), Nantes, Cécile Defaut, 2007.
[58] Gabriella Bosco, « Philippe Forest et la tierce forme, ou bien le roman (auto)critique », Revue italienne d’études françaises, 15 novembre 2018, disponible sur OpenEdition Journals <http://journals.openedition.org/rief/2054>.
[59] Laurent Zimmermann, « Passer les frontières », Acta fabula, t.°6, n° 3, Automne 2005, disponible sur Fabula <http://www.fabula.org/acta/document1103.php>.

