Cahier 1925-1937 (II)
… consulter à ce sujet ; mais environ 20 % seulement du personnel y adhéra, les autres, loin d’être communistes ou socialistes, donnèrent leur adhésion à la C.G.T. dont les délégués allaient trouver les ouvriers à domicile, en se présentant aux Cités, porte après porte, avec une escorte de fiers à-bras qui attendaient dehors, comme pour faire disparaître toute hésitation de mauvais aloi. Je reconnais qu’il fallait un certain courage pour refuser de prendre la carte de la C.G.T… Certains du reste, après l’avoir prise, allaient adhérer au Syndicat autonome !
Malgré que je me sois tenu à l’écart de ce nouveau syndicat, les communistes ne me lâchèrent pas et une affiche dénonça le « Syndicat Beugras » comme une nouvelle création fasciste et patronale.
Il y avait une huitaine que le « Rhodoïd » résistait à la grève. J’avais dispensé une quarantaine d’ouvriers dont le domicile était isolé et qui risquaient de mauvais coups, [ô liberté du travail !..], les autres venaient régulièrement. On avait procédé à tout ce qui pouvait se faire sans vapeur, à tous travaux de nettoyage ou de graissage. Sur ces entrefaites, je fus convoqué à Paris par M. Grillet. Il me déplaisait de quitter mon personnel dans ces circonstances, mais je ne pouvais m’en dispenser. Je dis simplement que je m’absentais 24 heures sans dire à personne ou j’allais et je rejoignis Lyon en voiture et de là Paris.
Le lendemain à neuf heures, j’étais au Siège social ; reçu de suite par M. Grillet qui me demanda : « – Que faisait votre personnel hier soir ? » — « Tout était calme, Monsieur. » – « Eh bien, répartit-il, tous vos ouvriers sont en grève depuis ce matin. Je ne sais rien d’autre sinon qu’une grande réunion a eu lieu hier soir qui s’est prolongée fort tard par des manifestations dans les Cités, et que ce matin vos ouvriers ne se sont pas présentés. » Je lui demandai de repartir immédiatement, ce qu’il m’accorda en me demandant de revenir sous quelques jours quand j’aurais vu exactement ce qui se passait. Le soir même, je débarquais à Lyon où M. Prince m’attendait à la gare. J’eus avec lui un entretien à l’Hôtel Terminus.
Après m’avoir confirmé les renseignements donnés par M. Grillet, il me dit : « Ne considérez pas cela comme un échec, tôt ou tard cela devait arriver. Les communistes ont dû y mettre le prix. Il n’en reste pas moins que vos ateliers ont tenu seuls alors que tous les autres flanchaient. Vos ouvriers ont fait preuve de confiance à votre égard, ne l’oubliez pas. La preuve est maintenant faite que votre méthode de commandement, de rétribution et d’aménagement du travail était la meilleure. Il est dommage que toute l’usine ne vous ait pas imité. Mais je souhaite que cette leçon ne soit pas perdue. »
Deux heures plus tard, j’étais de retour au Péage et retrouvais quelques hommes de confiance qui m’expliquèrent ce qui s’était passé en mon absence.
Mon départ avait été connu. Comment ?... Une réunion convoquée pour 21 heures avait été menée à grand spectacle et dirigée avec une extrême violence contre les « renards » et les « traîtres » à la classe ouvrière du Rhodoïd. Des manifestations avec hurlements de mort et pierres dans les vitres avaient eu lieu aux cités contre les ouvriers et les contremaîtres du « Rhodoïd ». Un groupe était même venu chanter « L’Internationale » devant ma porte et lancer des pierres dans mes vitres. Le lendemain matin, les piquets de grêve [sic] avaient été renforcés et des hommes veillaient devant le domicile des plus marqués de mes ouvriers. Quelques horions avaient été échangés. Une partie du personnel bloqué à domicile, les autres avaient hésité, et mon absence avait fait le reste.
Ce dernier noyau tombé, les communistes proclamèrent leur victoire, la C.G.T. menaça plus violemment ceux qui hésitaient encore à adhérer, et les dirigeants exigèrent la signature de la convention collective après huit nouveaux jours de grève.
La campagne contre moi reprit avec une violence accrue, exigeant cette fois mon départ de l’usine !... Pendant ce temps les lettres de menace donc j’avais l’habitude depuis plusieurs mois se firent plus nombreuses et menacèrent ma famille à un tel point que je dus faire partir ma femme et nos trois enfants du pays et les faire se réfugier, sous un nom d’emprunt, d’abord à Fontainebleau1, puis dans un village des Monts du Lyonnais.
Puis les conventions collectives signées2, le travail reprit sans du reste que cessât de se manifester à mon égard la hargne communiste. Je dois toutefois dire que sur la question de mon départ, ou au moins de mon déplacement, posée expressément par la C.G.T. à la direction de « Rhône-Poulenc », M. Grillet avait répondu avec beaucoup de hauteur et concluait en disant : « Vous pouvez décider de continuer la grève autant qu’il vous plaira, mais Beugras restera. »
Mais la pire des déceptions m’attendait, et là vraiment, j’ai appris à connaître un aspect des hommes qui m’a donné à réfléchir, et qui à lui seul suffirait à justifier la citation que j’ai placée en tête de ce chapitre. Mes ouvriers, pour lesquels je m’étais dépensé sans compter, pour l’intérêt desquels je n’avais pas hésité à risquer ma situation personnelle ; mes ouvriers, quand ils reprirent le travail – du moins en majorité – changèrent complètement leur attitude à mon égard et me reprochèrent de ne pas les avoir soutenus, autrefois, comme je le leur avais toujours laissé penser, et comme, effectivement, ils l’avaient cru.
Que s’était-il passé ? – La chose était fort simple : la C.G.T. avait obtenu par la grève et la signature de la convention collective des augmentations de salaires variant de 0,60 à 0,90 de l’heure. Or, moi – mais alors, bien sûr, qu’on baissait les salaires des autres ateliers, ou qu’en tout cas, on n’accordait aucune amélioration – il me fallait des demandes réitérées et des discussions interminables, des efforts inouïs et souvent des menaces pour obtenir des augmentations de 0,10 à 0,20 de l’heure.
« Alors, me dirent-ils, nous préférons avoir à faire à la C.G.T. qui défend mieux nos intérêts et obtient de meilleurs résultats… »
Tant d’efforts, tant de travail, tant d’âpreté pour en arriver là ! Pouvais-je seulement leur en vouloir ? N’était-ce pas encore la faute de ceux qui se prétendaient « l’élite », que de voir livrés, sans défense aucune, à la propagande la plus grossièrement mensongère et la plus honteusement démagogique, des ouvriers dont je savais, moi, – pour l’avoir constaté –, qu’ils n’étaient pas mauvais, que même une quantité d’entre eux étaient d’excellents hommes ?
Pourquoi aurais-je cherché à leur expliquer ce qu’ils comprenaient si mal ? Il était évident que pour eux les chiffres parleraient plus que tous les raisonnements qu’on pourrait essayer. J’étais ulcéré de devoir constater que mon action avait été si mal comprise et si je me souciais peu – en ce qui me concernait – des menaces communistes, dont les Espagnols étaient rendus encore plus arrogants par les événements de leur propre pays3, j’étais profondément déçu par le changement survenu dans mes rapports avec mon personnel.
Qu’on me comprenne bien, je n’avais jamais ni souhaité, ni espéré de la reconnaissance, puisque c’était en moi-même que je puisais mes raisons d’agir ; mais j’aurais voulu au moins la justice. Comme j’étais candide, encore !... J’étais, je l’ai dit, ulcéré et ne pouvais admettre de rester sur une telle désillusion, sur un tel échec envers moi-même. Je sentais qu’il fallait faire quelque chose, que c’était une lâcheté que de laisser le terrain au bolchevisme après une unique bataille, que tant de choses étaient menacées auxquelles je me sentais accroché du plus profond de moi-même : la famille, la patrie, la religion, la civilisation même ; mais je ne savais où me tourner parce que j’avais, au cours des années précédentes, dans les nombreux contacts humains pris à l’occasion de mon action sociale, découvert tant d’hypocrisie que je n’avais pas confiance et ne voulais suivre aucun des chemins battus.
J’ignorais à peu près tout de Doriot, sinon qu’ancien dirigeant du Parti communiste, il avait rompu avec celui-ci et lui portait depuis des coups sévères. Tout ce que j’en savais, je l’avais appris par les échos des hebdomadaires dont j’ai parlé. C’est alors, on était vers le 20 juin, que « Je suis partout » annonça que Doriot allait créer un nouveau parti de rassemblement des forces anti-communistes avec un programme constructif résolument et hardiment social. Dès cette nouvelle, j’écrivais à mon ami Pierre Courbon qui avait été pendant plusieurs années mon secrétaire et qui depuis quelque temps s’était retiré à Cannes. Nous avions bien souvent, ensemble, discuté des questions sociales et il était à peu près le seul auquel j’avais confié mes aspirations. Je n’hésitai pas à lui écrire ce qui s’était passé à Roussillon et la crise qui s’en suivait pour moi, le rendant attentif à la tentative de Doriot qu’on annonçait. Il pouvait d’autant mieux me comprendre qu’il avait été le témoin de nombre de mes efforts et qu’il savait avec quel cœur je m’étais toujours donné à ma tâche. Il ne me répondit pas, mais arriva le surlendemain. Nous eûmes une brève conversation qu’il termina en me disant : « Vous avez raison. Il faut faire quelque chose. Je vais aller voir ce que propose Doriot ». Et il partit à Paris. Je ne pouvais pas m’absenter car la remise en route des usines s’avérait ardue dans le désordre créé par l’agitation communiste d’une part, par la faiblesse gouvernementale d’autre part.
[…]
Consultez la suite du Cahier 1925-1937 (II) en format PDF
- 1. Chez le père de l’auteur.
- 2. La loi sur les conventions collectives est promulguée le 24 juin 1936. Ces accords sont négociés à l’échelle des branches professionnelles, ce qui permet, au moins en partie, de protéger les salariés contre l’arbitraire patronal. « Pour modestes qu’elles soient, les clauses des conventions collectives sont perçues comme une vraie amélioration ne serait-ce que parce qu’elles généralisent à l’ensemble des salariés des avantages dont seuls les privilégiés pouvaient jusque-là bénéficier. » Voir Laure Machu, « Front populaire : le temps des conventions collectives », CNRS Le Journal, 24 juin 2016, https://lejournal.cnrs.fr/billets/front-populaire-le-temps-des-conventions-collectives, consulté le 16 décembre 2020.
- 3. La guerre d’Espagne. Le Parti communiste espagnol, très actif, comptait 200 000 membres au début de 1937 et s’était engagé du côté des Républicains.
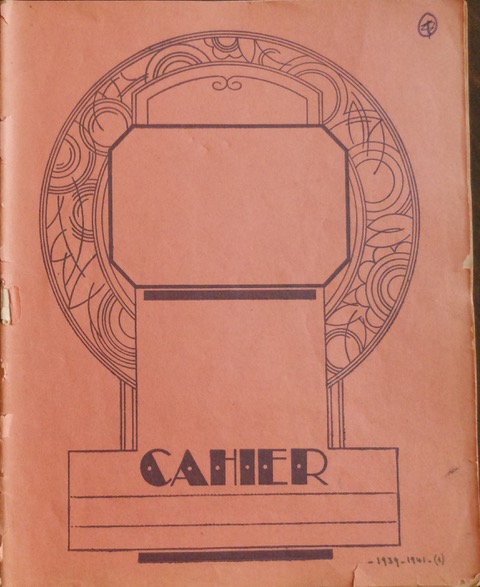 Archives personnelles Marie Chaix-Mathews
Archives personnelles Marie Chaix-Mathews, « Mémoires politiques d’Albert Beugras », éd. par Montémont Véronique, dans « Ego Corpus », EcriSoi (site Internet), 2021, URL : https://ecrisoi.univ-rouen.fr/ego-corpus/cahier-1925-1937-ii, page consultée le 06/07/2025.

